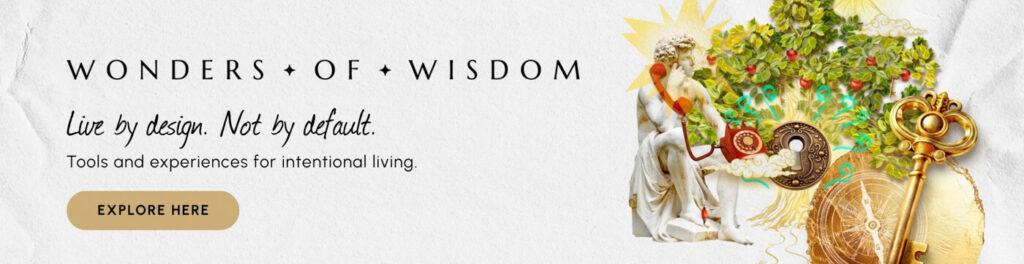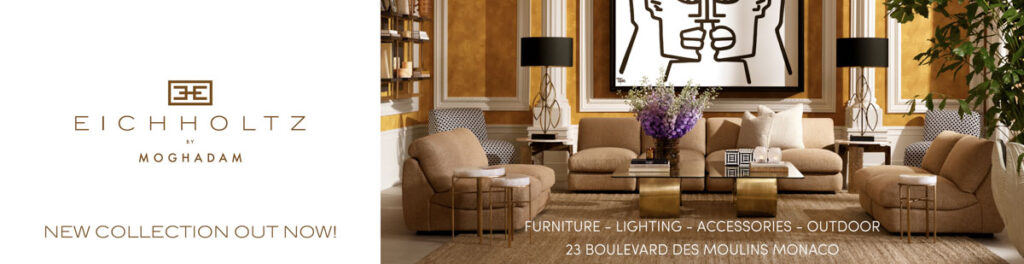Comment faire des grands événements sportifs un enjeu de durabilité ?

Organisé à Mandelieu-la-Napoule, le Congrès International du Tourisme Sportif a réuni acteurs et institutions pour partager leurs points de vue et ambitions pour construire un modèle plus responsable. L’occasion de nous demander comment tirer parti de l’expérience de Monaco.
C’est la question qui a orienté deux jours de débats à l’occasion du Congrès International du Tourisme Sportif, les 13 et 14 octobre dernier, dans un joyau de la Côte d’Azur, bastion du sport outdoor. Des enjeux de durabilité auxquels la Principauté se retrouve souvent confrontée, de par la multitude d’événements sportifs qui se déroulent chaque année sur son sol.
Que ce soit le Grand Prix de Formule 1, l’E-Prix, le Monte-Carlo Rolex Masters de tennis, ou encore le Meeting Herculis en athlétisme. Autant d’épreuves majeures dans le calendrier qui démontrent que Monaco est devenue au fil du temps une place forte, en étant désignée capitale mondiale du sport en 2025. Soit un an après le succès exceptionnel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une autre aventure qui, au-delà du succès populaire, a tenu certaines promesses, grâce à des alternatives écoresponsables, une mobilité adaptée à la demande et un accueil touristique à la hauteur.
Des enjeux d’attractivité et de durabilité
À la suite de l’obtention des Jeux dans la capitale française en 2017 jusqu’à son avènement il y a plus d’un an, le sport a basculé en France sur le terrain de l’événementiel. Les grands événements sportifs internationaux, appelés GESI, servent de rampe de lancement pour l’attractivité du tourisme sportif et ont un impact considérable sur la pratique du sport en elle-même.
Autant de motifs qui impliquent une mobilisation sans faille de chacun pour répondre à ces défis, notamment climatiques. C’était même l’un des axes de campagne marketing principaux de Paris 2024 : placer l’écologie au centre du projet avec pour ambition de réduire l’empreinte carbone de cet évènement international.

Les territoires qui accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2030 bénéficient de l’allant de ceux de 2024 et peuvent servir d’accélérateur à des projets plus écologiques. C’est la raison pour laquelle des réflexions existent en termes d’innovation technologiques, d’utilisation de l’eau à une moindre échelle. La question de la réutilisation est primordiale, car il ne s’agit pas de créer puis détruire, mais de s’appuyer sur les infrastructures déjà existantes et d’avoir des cycles de vie plus durables.
« C’est forcément un enjeu de transition puisque cela génère une activité économique, un prestige considérable. Il n’existe pas de modèle qui se révolutionne immédiatement. L’enjeu, c’est d’abord de mesurer l’impact des événements, sur la manière de le produire, d’utiliser l’eau, d’acheter du matériel… Il faut donc mesurer cet impact pour savoir comment le réduire », a expliqué Éric Patrigeon, directeur impact, héritage et durabilité Alpes Françaises 2030, présent au forum international de Mandelieu.


La Principauté en recherche permanente d’innovation
Le savoir-faire monégasque en la matière pour la tenue des événements sportifs pourrait servir d’exemple dans la perspective de l’organisation des JO d’hiver en 2030 dans la région. « Les endroits où il y aura du monde sont ceux ayant le plus de capacités à accueillir. La ville voisine de Nice le fait en permanence. On va axer notre travail sur l’intermodalité pour faire en sorte que vous puissiez vous rendre en transport en commun jusqu’au site et revenir à votre hébergement […] Il faut atteindre un objectif de mobilité décarbonnée, et éviter autant que possible d’utiliser son véhicule personnel », a-t-il ajouté.

Monaco fait justement face à ces questions environnementales depuis 20 ans et ses engagements en faveur de la transition écologique portent leurs fruits. Preuves à l’appui, les voitures électriques et hybrides représentent 20% du parc automobile et les autobus basculeront entièrement d’ici la fin de l’année vers l’électrique. Ce qui fera de la ville l’une des premières au monde à atteindre cet objectif.
L’hébergement et la restauration au cœur du projet
Autre secteur indispensable au besoin des touristes, celui de l’hôtellerie-restauration. La région de la Côte d’Azur recense 300 000 séjours touristiques par an sur un total de 12 millions de visiteurs annuels selon Claire Behar, directrice générale de Côte d’Azur France Tourisme. Avec une forte concentration pendant la période estivale. En 2023, à Monaco le taux d’occupation des hôtels a atteint 75 % en juillet et 72 % en août, contre 57 % en moyenne sur le reste de l’année, d’après les chiffres de la Direction du Tourisme et des Congrès. Des données qui traduisent une nécessité de désaisonnaliser cette attractivité touristique, souvent réduite à la période estivale.
Y compris auprès des sportifs professionnels que la région azuréenne essaie d’attirer en dehors de la haute saison. Pour cela, une charte d’accueil, composée de 40 critères, a été mise en place pour s’adapter à leurs besoins pratiques et nutritionnels, sans oublier la mise à disposition de services, que ce soit des salles de performance, de repos, de massage, de soin, de vidéo. Une offre haut de gamme dont dispose également la Principauté, grâce à une clientèle premium historique.
Depuis cinq ans, il existe 66 établissements labellisés dans la métropole Nice Côte d’Azur. Ces labels demeurent essentiels pour certifier l’authenticité des hébergements des athlètes comme des touristes sportifs et servent à fédérer. Lorsque les fédérations envoient leur calendrier, ces centres se mettent en ordre de marche pour réceptionner les personnes afin de les mettre dans les meilleures conditions. Des possibilités d’élargir le cercle local peuvent être mises en application, un mécanisme qui demande une synergie avec les différents partenaires (communes, entreprises) pour se développer davantage.